Tu as regagné ton île et c’est moi qui suis en exil, désormais. Tu as rejoint ton royaume, me laissant un désert, vaste comme mille saisons, ou comme une galaxie. Tu es dans le mouvement de ton île, dans ses affluents de lumière et de vent, et d’embruns, et chaque jour tu peux croiser la ligne d’horizon avec ta ligne de vie.
Tu es sur ton île avec toutes ses rigueurs qui s’opposent à l’océan, et ses consentements, et ses complicités. Ses résistances, aussi. Et les marées recouvrent et découvrent le temps, inlassablement, infatigablement. L’azur, l’azur et son carnage, sa véhémence. L’azur, impossible continent, intouchable, inaccessible azur. Un horizon nous sépare, et la houle pulpeuse, et son balancement, et son indifférence, et son détachement.
Tu as rejoint ton royaume me laissant un néant, et la maigreur d’une saison miséreuse à la dérive. Et tu peux croiser l’horizon avec ta ligne de vie, effilochant imprudemment ma ligne de cœur.
Tu as regagné ton île et c’est moi qui suis bannit, relégué dans mes terres, à user les vieux pavés des veilles villes, à périr chaque fois un peu plus dans de nocturnes fournaises.
Tu t’es éloignée sur ton île, sur cette roche marine martelée de colère, sur ce coriace heurtoir à tempête. A présent tu es sur ton rocher comme une figure de proue, transie et résignée. Les bras tendus vers le large, et les yeux grand-ouverts.
Ta terre îleuse est sans moisson, elle est tout en crainte orgueilleuse, tout en brûlure de sel, et le vent s’y frotte, s’y blesse sur ses rocailles sorties de l’eau, comme un os qui percerait une peau humaine. Le squelette d’un fantôme naufragé, cuirassé de granit. Et le vent s’y frotte, geint, supplie, il est tout à sa douleur, et à ses hurlements, mélangeant ses cris, aux cris des macareux et des grands goélands.
Les semeurs de ton île jettent leurs grains aux cieux pour les faire fleurir, pour conjurer le sort en guise de prières, pour faire rire les étoiles, ou pour les faire pleurer.
Les semeurs de ton île jettent leurs filets au loin pour attraper un peu de ciel et de lumière, une brassée d’éternité.
Et le temps sur ton île s’effiloche entre le clapotis et les marées, entre la patience et les larmes trop salées. Les vœux des îles ne sont jamais exaucés. Trop de hasards, trop de fatalités, trop de pleines lunes mortes avant le petit jour, trop d’accablement, trop de saisons défuntes, de cimetières fatigués, trop d’attente. Oui, trop d’attente. Bien trop d’attente.
Et ton île se gonfle comme si elle respirait, comme si elle était le cœur d’un grand géant de pierre allongé dans ces vagues qui bordent son sommeil austère de draps brodé d’écume et de rumeurs sauvages.
Tu es sur ton île rugueuse et sévère, sur le contre-point de nos enlacements, et j’ai beau gratter mes mots jusqu’à la transparence, les râper, les user, ils ne peuvent rien contre cet éloignement et la désarticulation de nos caresses. Tu es sur ton île, ton île plus habitée par les morts que par les vivants, ton île où les aubes se lèvent toujours sur des jours ancestraux, des jours déjà vieux, vieux de souvenirs et d’attente vaine.
Et maintenant que tu es sur ton île, ma seule boussole est ton nom, et mon texte un bien pauvre navire pour franchir l’océan, un radeau halluciné plutôt. Et ma voix est une saumure saturée de sel.
Les îles sont sans sommeil, elles sont seulement nues, et silencieuses, elles veillent sur l’absence, c’est leur façon d’aimer. Elles craquent, comme les vieux arbres, elles râlent comme des fauves blessés, c’est leur façon de résister.
Elles hurlent, c’est leur façon de désirer.
Alors j’irai sur ton île. Même mort j’irai, pour qu’une dernière fois nos silences se mêlent. Alors mes lèvres salées sur tes lèvres salées, et mon souffle épuisé sur ton souffle océan. Alors j’irai sur ton île, mon amour, offrir ma main paysanne à ton âme marine, et mêler ma terre noire à l’écume de ta chair. J’irai sur ton île, mot après mot, et je ferai un pont sur les deux rives de l’horizon. Et je traverserai, et tu traverseras. Et nous chevaucherons l’atlantique, comme deux cavaliers fous, c’est le vœu des enfants, c’est le sort des amants.
Le destin des étoiles.
Franck.







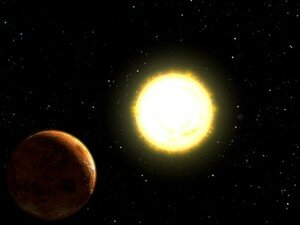


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F33321.jpg)