J’ai repris « ma » tentation de Saint Antoine. Du temps a passé. Quand je relis cette écriture je sais bien que du temps a passé. C’est dans l’avant. L’avant de quoi ? Je n’écris plus vraiment comme ça. Mon Saint Antoine cède. Il y a quelque chose en moi qui cède. Toujours cette même impression de digue débordée. D’écoulement. D’hémorragie. Des sensations d’eaux. Flaques, sources. Océans.
Marais.
En se moment c’est un marais qui suinte.
« J’ai marché en marge de ma vie.
De longues années
Sans doute même de longs siècles
Pour m’arrêter un jour au bord de votre visage
Et j’ai voulu m’asseoir
Et ne plus bouger
Jamais
Simplement vous regarder
Toujours… »
L’image de cette reine de Saba a toujours traversé mon imaginaire. Reine boiteuse. Mais reine quand même. Et l’improbable rencontre du désert. Chair contre oraison. Bruit contre silence.
« Au creux d’une défaillance de lumière j’ai vu au fond de vos prunelles les grandes étendues de poussières blanches du royaume de Saba
Aux confins de tous les déserts
Là où les prières deviennent de simples souffles
des chants d’azur éparpillés
Souvenez-vous, en ces temps là vous étiez reine
Reine gracieuse à la pâleur singulière
Reine du pays du vent
Vous trôniez au centre d’un temple de sable, d’étincelles d’éternité
Souveraine majestueuse d’une citadelle de lumière et de tourbillonnement
Princesse immaculée miraculée des limbes juste assez boiteuse pour ne point offenser Dieu
Votre présence effleurante flottait légèrement comme un lambeau de rêve
Ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs
Oui, vous étiez reine vos gestes le dessinait
Déesse, vos yeux le révélaient
Et votre voix chantait le chuchotis des amants éternels… »
Mes souvenirs du désert sont construits sur le manque. Sur l’absence. Sur le malentendu aussi. Sur la fuite que je n’ai pas reconnue, sur la lâcheté que je n’ai pas voulu voir. Pendant des mois j’ai attendu ce qui ne viendrait jamais. J’ai interrogé le vide des sables. Je n’ai eu aucune réponse. Pouvait-il en être autrement ?
« En ces temps là, ermite désolé, je vous ai vu venir, vous sortiez de la nuit emmitouflée d’ombres claires, drapée d’un grand voile constellé
En ces temps là mes os grinçaient de peur
Je passais de dune en dune, de jour en jour, de blessure en blessure, conquérant d’un vide toujours à venir dans la seule espérance d’une stridence inattendue
Le cœur vert
Je passais les bras ouverts au grand vent chaud étreignant des mirages si lointains
Entre mes doigts coulaient déjà ces cendres de temps
J’étais une étoile noire tombée dans de trop grands hasards
De sombres hasards
Un baiser m’eut sauvé
Pas même un baiser
Rien
Pas même une enfance
Seulement des restes d’amours effilochés
En ces temps là votre silhouette délicate est passée sur mon cœur
A glacée mon sang
Votre parfum disait l’infini de l’espoir… »
Mon rapport à la solitude est étrange. Plus le temps passe, plus je la ressens comme une évidence. Nécessaire. Je n’ai jamais pu vivre dans le monde. Je le traverse à mon pas, avec mes hésitations, mes élans. Mais je ne m’arrête pas vraiment. Voyageur immobile.
Je relis. Je n'écrirais plus comme ça. Pourtant je n’arrive pas à reprendre le texte. Je sens bien ma volonté dans ces lignes de m’accrocher à une sorte de lyrisme. Je me revois écrire. A nouveau je ressens le mouvement premier d’aller chercher les mots.
Mais je ressens aussi très fort une distance entre moi et le texte. Il manque une adhérence. Il manque le frottement.
La solitude est le travail de toute une vie. Elle n’est pas donnée tout de suite. Comme s’il fallait la mériter.
Dérision, que de devoir se diriger toujours vers le plus invivable.
« Alors au fond de l’horizon le soleil tout à coup bascula dans son lointain sépulcre
Souvenez-vous
J’ai vu votre beauté, légère comme un ciel d’été, glisser avec douceur vers le seuil inconsolée de ma retraite obscure, votre lumière bleue avait la transparence envoûtante de ces jeunes mamans penchées sur un sommeil d’enfance, dans vos yeux scintillait cet espace d’éternité qui appelle la joie pure d’une prière lancée au firmament.
Votre présence fut comme un souffle de mésange, un frôlement rayonnant, une pluie étincelante semée sur mon océan de langueur
Une fleur mystérieuse plantée au jardin de mes absences…. »
Non, décidément je n’écrirais plus cela. Pourtant je n’arrive pas à me renier. Comme si cette forme était le premier sillon. La première griffure. L’entame. Se débarrasser de la lumière. Ne travailler les mots qu’à la bougie. Il faut une tremblance, un vacillement. Des jeux d’ombres. Le sentiment d’une perte possible. D’un effondrement. Il faut l’imminence d’un danger derrière la phrase. Ce n’est pas une question de sobriété, mais d’élan. Du lieu de départ de la parole. La tension de la corde. Le tireur à l’arc, le sait. C’est aussi le travail d’une vie. Tendre l’arc de la parole dans un mouvement ample. Sans crispation. Sans effort. C’est une respiration. Lâcher la flèche du mot requiert un accord, c’est un geste de prière. Accord et consentement. Lâcher se fait sans la volonté. C’est une nécessité du corps aussi ben que de l’esprit. Ce n’est pas la main qui lâche, c’est la foi qui nous étreint. Quelque chose en nous se condense. Le fond et la forme. Et la scansion, le rythme, le battement du cœur. A cet instant le texte respire à notre place. Échange. A cet instant du lâché on se retrouve au point exact de la vie et de la mort. Sans le tragique. L’inéluctable. L’embrassement du monde. Car le mot doit trouver sa place, seule le geste pourra la lui donner. L’abandon n’est pas ici une déroute. Pas encore. Pas tout à fait.
« Nous sommes entrés sans prononcer un mot dans la chambre nuptiale de la nuit
laissant grand ouvert les cristallines portes de l'infini pour laisser passer la clarté nuageuse des songes et la fourmillante folie des séraphins éthérés.
Et j’ai bu votre bouche fondante comme l’hostie sacrée et me suis enivré d’une sève à la saveur irréprochable
Dans ces heures rougies au feu des extases éruptives, blanchies aux soupirs de vos invitations ma mort fut percée d’une flèche de lumière argentée.
Sur votre épaule nue un ange a déposé ses ailes de silence et sur vos seins opalins j’ai pu laisser couler mes larmes quand votre ventre orageux traversait mon âme transfigurée d’éclairs rougeoyants.
Vos entrailles de chairs pourpres brûlaient mes oraisons laborieuses dans une fulgurance invincible, vertigineuse. Je me noyais sous l’arche inespérée de vos émois, balayé par des rafales de joie… »
J’aime l’idée que Saint Antoine ait pu céder à la reine de Saba. Un saint qui n’aurait pas cédé à sa propre lâcheté qu’aurait-il à nous dire ? Nos actes ne sont pas purs. La flèche en partant nous atteint en plein cœur. Et nos blessures nourrissent nos jours. Même innocents nous nous voulons coupables. J’aime l’idée d’un Saint Antoine débordé par la chair, par la luxure et la sensualité. Que vaudrait la prière sans le souvenir de la véritable chair.
La peau d’Isabelle était blanche. J’ai encore le parfum de son corps dans ma mémoire.
« Et j’ai vu mes mains de prières sur votre corps de louanges… »
Souvent les yeux d’Isabelle étaient envahis de larmes. Comme si jouir et souffrir était la même chose. Le corps repu, elle restait silencieuse. Blottie. Avec les larmes qui coulaient. Ce n’était pas un chagrin, c’était autre chose, qui dépasse tous les mots qu’on peut dire. C’était le pays des landes, des vents, des brumes. Perdre ou gagner n’a plus de sens.
« Et j’ai vu votre ventre lieu infini de la mort exacte
Et j’ai eu soif de vos eaux généreuses, ce rien à l’âme qui bouleverse toutes les certitudes : marée sauvage, sans retour, sans rémission, effroyablement délicieuse
Et j’ai ouvert les mains pour recueillir jusqu’à l’ultime goutte de vos bruissements et je n’ai pu saisir que l’or de vos silences… »
Isabelle avait ce don étrange de la pudeur et le l’indécence, presque dans le même mouvement. Allongée sur le lit, un bras replié sous sa tête, une cuisse légèrement relevée et écartée, une main posée sur son sexe.
Nous ne parlions pas. Elle, comme moi étions dans l’impossibilité d’accrocher la moindre parole à ces instants. Je la regardais. Je baisais ses larmes.
Parfois cela durait longtemps.
« Nous avons partagé la nuit et ses gerbes étoilées recouvert d’un seul manteau de paix jusqu’à ce que l’aube de sable pousse un large soupir incandescent.
Une rose des sables, rouge.
Dans l’athanor creusé par nos corps, là où votre peau s’est irisée de désir vertical a germé une rose des sables, rouge… »
Il y a un mystère dans les corps. Dans la rencontre des corps. Dans leurs odeurs, leurs tremblements, leurs sueurs, leurs liquides. Au-delà de la jouissance brutale il y a un mystère, comme un appel, comme une rémission.
Parfois dans l’écriture cette sensation revient. Quand on a tout épuisé. Et que le texte s’étale impudique et souverain. La flèche trace, vole droite, et perce la cible. Et la cible vibre de son centre troué.
« Il ne me restait qu’à attendre l’achèvement des temps en recueillant l’écumeuse blancheur des jours indifférents et de regagner à pas lent mon impatience souveraine à nouveau consentie. Erosion lancinante sous l’œil noueux du souvenir
Frontière sablonneuse inviolable de l’exil… »
Saint Antoine n’était pas artiste, il ne fut que saint.
« Au départ il n’y a rien
A la fin il n’y a rien
Entre les deux la mer
L’abîme
Oh, mon Dieu je suis là et je cherche à comprendre
Oh, mon Dieu la nuit n’est plus la nuit
Elle était une source…..elle devint l’océan
Elle était une étoile ….elle devint l’univers
Oh, mon âme brûle et je suis si pauvre seigneur
Je n’ai plus d’espérance mon seul désir est de prier sans fin au cœur de la nuit du monde.
La prière s’enroule au feu de nos secrets, seul l’écho de cette nuit du monde la porte, légère, douce, tendre, on croirait la voir s’élever sur les ailes d’un ange
… Et jusqu’au royaume des cieux… »
Il y a un acte de purification dans l’écriture, d’où la brûlure.
Après le tir, l’archer est comme un orphelin. Quelque chose l’a quitté. Quelque chose de lui, mais du monde aussi.
A la place un grand champ de neige et dans le lointain le cris des oies sauvages vers le nord.
Franck.
 voix incendiée, elle se déshabille, impudique et offerte. La parole amoureuse n’est pas belle, puisqu’elle a quitté la terre et qu’elle est insensée, et qu’elle est inaudible. Et qu’elle est sans intelligence puis que c’est la seule parole vraie, jamais dite. Et qu’elle est sang, feu, dévastation, anéantissement.
voix incendiée, elle se déshabille, impudique et offerte. La parole amoureuse n’est pas belle, puisqu’elle a quitté la terre et qu’elle est insensée, et qu’elle est inaudible. Et qu’elle est sans intelligence puis que c’est la seule parole vraie, jamais dite. Et qu’elle est sang, feu, dévastation, anéantissement. peaux mortes, les chairs molles, les os cassants et le mur de silence qui la protège de l’indécence, et de l’impudeur. Elle se consume dans le baiser qui la souffle et renaît de son propre désarroi.
peaux mortes, les chairs molles, les os cassants et le mur de silence qui la protège de l’indécence, et de l’impudeur. Elle se consume dans le baiser qui la souffle et renaît de son propre désarroi.



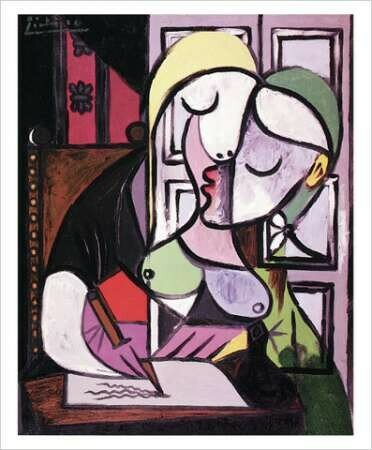









/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F33321.jpg)