L’écriture tient dans cet effort à gagner une rive qui se refuse à notre brasse. Dans cet échec toujours renouvelé. Et  consenti. De la mer dont on est sorti il nous reste le mouvement lent et monotone, et parfois furieux, des marées. L’impossible immobilité. L’impossible rivage. Et l’écriture s’essaye à définir les contours d’une réalité sur laquelle on ne pourra prendre pied. Avec ses noces impraticables. Imaginaires. Illusoires. La plage est une cicatrice. C’est pour cela que les amants s’y confessent. Ils ont l’instinct des tragédies et des sacres. Et l’écriture tente de regagner la plage, de rejoindre les amants, elle a l’instinct du sacrifice. Et l’écriture, et les amants sont dans le même lieu, dans le même temps, et ils ne peuvent pas se voir, et ils ne se rencontreront jamais. Et c’est dans ce jamais, qu’il faut hasarder sa vie. La concevoir et l’endurer. Et le poète tourne le dos aux amants de la plage, et choisit l’horizon. Parfois certains amants le suivent. C’est rare. La couleur bleue de la mer vient de là. Des naufrages des amants. Et de leur résurrection au fond des océans. Et du chant des poètes qui n’en finissent pas d’agoniser.
consenti. De la mer dont on est sorti il nous reste le mouvement lent et monotone, et parfois furieux, des marées. L’impossible immobilité. L’impossible rivage. Et l’écriture s’essaye à définir les contours d’une réalité sur laquelle on ne pourra prendre pied. Avec ses noces impraticables. Imaginaires. Illusoires. La plage est une cicatrice. C’est pour cela que les amants s’y confessent. Ils ont l’instinct des tragédies et des sacres. Et l’écriture tente de regagner la plage, de rejoindre les amants, elle a l’instinct du sacrifice. Et l’écriture, et les amants sont dans le même lieu, dans le même temps, et ils ne peuvent pas se voir, et ils ne se rencontreront jamais. Et c’est dans ce jamais, qu’il faut hasarder sa vie. La concevoir et l’endurer. Et le poète tourne le dos aux amants de la plage, et choisit l’horizon. Parfois certains amants le suivent. C’est rare. La couleur bleue de la mer vient de là. Des naufrages des amants. Et de leur résurrection au fond des océans. Et du chant des poètes qui n’en finissent pas d’agoniser.
Car il m’a fallut naître….
Naître…..Naître…….Naître…..
ÐÑ
Le reflux
La douleur violente c’est peu à peu retirée. Marée basse. Lentement retirée. Chaque instant nouveau découvre l’étendue du désastre. L’infini du désastre. Plus je suis déserté par les eaux plus je perçois l’effroyable déchirure. Ecartelé, déchiré, je ne sens plus la torture dans ma peau, dans ma chair, dans ma viande. C’est plus sournois, plus diffus. Comme de l’eau qui se retire d’une plage. Une eau pleine de lassitude. Un effondrement si lent. Un effondrement vague après vague. Effondrement d’énergie. De l’âme. Après le corps c’est toujours l’âme qui veut disparaître.
Quelque chose de l’unité n’existe plus.
A chaque instant je crois me dissoudre dans le vide laissé par la déchirure, par la vague. Il n’y pas d’angoisse, pas de peur, seulement une tension permanente. Permanente, lancinante, agaçante. La sensation que l’océan se vide vague après vague. C’est ça qui use. Etre l’alpha et l’oméga du néant.
Au-delà du désespoir.
Un désespoir qui n’a pas de forme, pas de résistance. L’eau de l’âme déserte la plage. Il n’y a plus rien que le vide. Vague à l’âme. Vide épais, pesant. Le vide ce n’est pas un rien sans consistance, non, c’est un rien compact, pâteux. Il est sans forme, mais il est lourd, tellement lourd. Lourd comme l’éternité, comme la mort.
Vague après vague je disparais un peu plus, recroquevillé sur mon vide, sur mon absence. Séparé, divisé, déchiré, en exil de la vie. L’autre vie. Celle d’avant.
Avec seulement cette tension. A moins que ça soit çà. La vie. Le souffle tendu dans une attente vaine. Pas d’envie, pas de désir, que de l’attente. Attendre l’envie et le désir. Espérance de désir... pour désirer rien. Rien, jusqu’à la fin des temps.
Se souvenir. Ca ne marche pas. Je n’ai pas de mémoire. Les images semblent sortir de mon corps. Plus vivantes que moi. Mais ce n’est pas du souvenir. C’est du sang que j’entends battre sur mes tempes, c’est l’odeur qui envahie mes fosses nasales. Ma gorge.
Noir. Tout le reste est noir. Je n’ai plus de passé, d’ailleurs je n’ai plus rien. Je ronge l’attente comme un vieil os usé. Je ne peux même pas me tuer. Il n’y a rien à tuer. Personne. Je suis là. C’est tout, je suis là. Mais je n’existe pas. Tout a reflué. La plage est déshabillée, nue.
Je suis nu. Non. Je suis rien.
Quelque chose passe, s’épuise. Je ne sais pas ce qu’est le temps. Quelque chose s’épuise. Quelque chose en moi s’épuise. Du temps, du rien. Sans violence, sans révolte, comme la mer qui se retire. La mer qui s’enroule sur elle-même, qui s’absorbe elle-même, qui ravale ses sanglots, vague après vague, laissant derrière elle cette hideuse dentelle moussue, rouge, silencieuse qui s’accroche encore à quelques cailloux miséreux, qui n’en finissent pas de s’user, eux aussi.
Je ne suis plus lié à mon corps. Je sens quelque chose qui résiste, alors je dis que c’est mon corps. Mais je ne suis pas sûr. Avec les dernières vagues mon image disparaît et les miroirs se taisent. Ils ne me savent pas. D’habitude les miroirs savent les images. Là, ils ne me savent pas. Pas encore. Pour toujours. Peut-être.
J’ai les yeux tournés vers l’intérieur. Même pas. Je suis aveugle. Le monde a perdu son épaisseur. Etranger, abandonné au-delà de la mer.
Au-delà de la mère. Bien après la dernière vague. Ce n’est pas un lieu, c’est…. ça ne se défini pas. Ca ne se dit pas.
La plage est vide, encore humide. J’ai tout oublié, l’eau, la tempête, le bruit, les cris, la souffrance. Je ne souffre pas. C’est pire.
Je vis.
Au fond de ma gorge, ce goût fétide qui m’empêche d’hurler. Ce goût laissé par la dernière vague. Senteur marine. Non, plus fade, comme l’odeur blanche de la mort. Je suis là dans un présent mobile, indéfini. Je ne sais pas si je dors, je ne fais pas la différence. A cause, sans doute, de ma mémoire. Saturée de douleur, de néant.
Le seul mouvement qui me reste c’est celui de la mère qui s’enfuie.
Je m’éloigne du rivage.
Toujours un peu plus.
J’entends ma respiration. C’est la mer qui rumine. La mer monstrueuse méduse halète.
Allaite.
Je vois son corps immense trembloter. Non, c’est moi qui tremblote. Je suis une méduse qui tremblote. La transparence épaisse d’une méduse échouée au bord de l’océan : et qui tremblote.
Une mère à marée basse laisse toujours une impression d’inachevé.
D’inachevé.
Elle pourrait descendre encore, descendre sans fin.
Mais, à un moment donné, il y a la dernière vague. Puis plus rien. Puis l’attente.
ÐÑ
L’étale
A force d’attendre je crois voir les images.
Des morceaux d’images.
Mon corps de méduse est trop mou pour accrocher les images. Pourtant je les sens, elles s’incrustent, elles glissent, elles rampent. Ma tête ne peut les retenir. Ma chair non plus. Je ne comprends pas. Pas de maîtrise, pas de sens, pas de forme. Rien qu’une femme écrasée dans les plis désespérés d’un corps mou, translucide. Et moi. Et ça. Morceau d’image. Morceau de corps.
Pas de son, pas d’odeur.
Peut-être une odeur. Je ne peux pas dire ce que c’est. Une odeur. De toute façon elle est mélangée à la couleur. Peut-être l’odeur de la méduse. Je ne sais pas d’où elles viennent, les images. Les morceaux de cette femme. Cette femme éventrée. Il n’y à pas de sang. Pourtant elle est éventrée. Je le sais. Quelque chose de la méduse le sait. Au bout de la mère, au bout du mouvement ces choses là se savent. Tout le monde le sait qu’elle est éventrée. Pas besoin de sang pour le savoir. Les méduses ne saignent pas.
Immobile.
Je sors d’une blessure baveuse.
Je suis la blessure.
Pour toujours.
La mère immobile. Seulement les images superposées de cette femme. Je sais que c’est moi. Je ne le vois pas. Je le sais. J’ai toujours su qu’elle était éventrée sur des lits poisseux de désir.
Ma peau est gluante comme une méduse gluante.
Pour toujours.
Elle a cette sorte d’immobilité étrange. L’image. La femme. La mère. L’immobilité vertigineuse des rêves. La peau est pâle. Il faut dire la viande. La viande correspond mieux à ce que je sais. Une viande gluante, visqueuse, ouverte.
La femme est ouverte. Les cuisses sont ouvertes. C’est normal. C’est toujours comme ça. On dirait une méduse oubliée au bout d’une plage. Elle. Moi. Je ne suis pas sûr, parce que se sont des morceaux d’images. Et puis, je n’ai pas tous les mots parce que je suis en morceaux et ouvert.
Non, c’est elle qui est ouverte. Quand on est ouvert, on n’a jamais tous les mots. Je le sais. Tout le monde le sait.
Il faudrait faire des phrases. Pour mieux respirer. Des phrases longues avec de la mémoire. Je suis sûr qu’il faut de la mémoire. Tout le monde a de la mémoire et peut faire des phrases longues qui racontent des histoires. Les phrases longues, c’est pour raconter les histoires de la mémoire. Les histoires du temps. Du vrai temps.
Avec de l’avenir et du passé.
Non, pas du passé.
Plus jamais du passé.
La mémoire ce n’est seulement que pour du passé.
Je n’ai pas de passé, alors je n’ai pas de mémoire. Les images, c’est du présent. Rien que du présent. Tout est enfermé dans les images. Tout s’y arrête, comme la mer, comme la méduse.
Si seulement l’eau pouvait revenir. La mère. Mais elle est basse, moi, je suis trop las, trop lisse. Même éventré.
Trop lisse. Eventré de l’intérieur.
L’exil.
Je suis exilé. C’est le mot qui convient. Hors de mon lieu. Prisonnier ailleurs, plus loin, encore plus loin, dans les images sans doute. A l’intérieur c’est vide. C’est pour ça que je suis exilé. Un vide à l’intérieur qui sépare et déchire.
ÐÑ
Le flux
Seulement un peu d’eau.
Le moment où l’univers reflue.
L’eau suce à nouveau la terre.
La terre aspire.
J’aspire
Comme un trop plein de vide.
Jusqu’à l’écœurement.
Tout d’abord il y un bruit imperceptible. Un peu de mousse qui se forme. Quelques bulles, un peu comme de la bave qui viendrait blanchir le sable. A nouveau. Quelque chose à nouveau s’accroche.
Entêtement fatal.
Avant le mouvement il y a l’intention du mouvement. Un désir, un rien. L’écume baveuse qui vient mouiller un peu plus loin le sable. On pourrait croire que cette mouillure tente de surgir du sable. Une mouillure de l’intérieur du sable.
Avant le mouvement il y a cette impression de suintement de l’intérieur.
La respiration vient après.
Du silence sort un souffle.
Il est diffus. Il est là : lent, profond, inévitable.
Inévitable.
C’est vraiment un souffle. Une respiration vivante.
L’infini qui respire.
Un trouble. Une ivresse.
Sensation troublante, comme est troublante l’apparition de cette mouillure venue de l’intérieur. Quelque chose de vivant. Trop vivant.
Cette respiration, cette succion, cette bave.
Rien n’est coordonné. Je ne perçois ces éléments que séparément. Pas d’unité.
Il n’y a pas d’unité.
Au début il n’y a jamais d’unité.
Que ce souffle. A l’intérieur. Plus d’eau. Seulement le souffle. La mémoire de l’eau qui berce.
Quand la mère se retire.
Quand la mère se retire il y a l’effroi. L’abandon à l’effroi. Bercé dans l’effroi. Je crie.
Rien que du cri. Pas les mêmes cris. D’autres. J’en ai plein la gueule. Ils me submergent, m’envahissent.
Maintenant la mer est à l’intérieur. La mère. Je crois. Son mouvement. Tout remue à l’intérieur avec cette respiration. Une vague moussue m’enveloppe, mais en dedans. Elle clapote insignifiante et têtue.
C’est quoi le néant ? La mère peut-être ? Sans doute. L’extase des ténèbres. La mère c’est toujours l’extase des ténèbres. Elle est là dedans. A jamais. Fascinante comme la mort, ou quelque chose qui y ressemble. La seule chose vivante ici c’est la mort.
Elle monte à l’intérieur comme une marée naissante. Le flux de la mort. Le reflux de la mère.
Maintenant la mer est là, qui monte comme une désespérante envie. Inexorable attraction du désir. Douloureux dans la chair. Plus profond encore que la chair. Dans le ventre. J’ai un océan dans le ventre. Un océan de désir douloureux dans le ventre. Quelque chose qui grossi, qui déferle. Vague après vague. Toujours plus haut. Plus fort. Impitoyable avalanche de la mer qui monte du plus profond du ventre.
Tout s’agite. Maintenant. L’univers bouillonne. Plus bas que le ventre, à l’endroit ultime d’où la marée remonte. Le seul endroit. Le lieu. D’où se dressent les vagues. Le trou obscur de l’univers.
J’entends les bruits de la mère. La mer s’arque boute sur un désir convulsif pour enrouler ses vagues toujours plus loin dans le ventre, vers une plage inaccessible.
Inaccessible. Voilà, c’est tout. Inaccessible. Le reste, tout le reste est un perpétuel recommencement.
La seule réalité se sont ces marées inutiles dans un univers inutile.
Il y a quelque chose de vain dans les marées. Pendant un instant, pendant que la nature pousse on se prend à espérer. Puis elle reflue. Se recroqueville.
Les marées n’accouchent de rien. La mer n’accouche de rien. La mère aussi.
Sûr d’une chose. L’invincible douleur. Le mal absolu de la déchirure.
Rien d’autre.
Se taire.
Regarder la mer jusqu’à l’ultime marée.
Tout est dans ce mouvement qui donne l’illusion de la vie. Va et vient. Apparition. Disparition. On croit naître de ce mouvement. Illusion.
J’existe depuis avant. Avant la déchirure. Avant le mouvement.
Comme la méduse.
Je suis né d’un va et viens. Du frottement des chairs. De l’usure désespérée des chairs entre elles. Rien de plus. Rien de moins.
Rien de beau là-dedans. L’usure inéluctable du va et vient des chairs. De la mer. De la mère. Né d’un épuisement de l’eau.
Illusion d’amour ou croire à la nécessité des choses. Rien n’est nécessaire. Au mieux il y a l’usure.
Danse macabre de l’usure des chairs. Deux méduses aussi vaines l’une que l’autre. Rien de nécessaire là-dedans.
L’amour. L’absence. Illusion de l’autre. C’est toujours le même vide, à cause de la même déchirure. La mer se contemple seul.
La mère aussi.
La seule réalité c’est le va et vient de la mer, ces marées qui montent et qui descendent, cette usure des chairs. Il n’y a rien à trouver, pas le moindre sursit.
Au mieux expier des illusions. Pris dans un jeu de reflets.
Jouet des transparences.
Pourtant la jouissance se dit dans des hurlements de bête.
La naissance aussi.
Les mêmes cris. Je viens de cette usure des chairs et d’un désir douloureux.
D’un reste.
D’un surcroît de tristesse au bout d’une plage désertée.
D’un épuisement.
Ne l’oublie jamais. Jamais. Méduse abandonnée. Rien de plus.
Le reste d’un combat obscène et douloureux. Des corps qui s’entremêlent dans le désordre d’un désir brutal. Des corps qui mugissent, se tordent. Des corps violents. Des chairs offertes.
L’extase. Comme un effondrement. Comme à l’heure incertaine du soir. Heure incertaine…. Plus tout à fait le jour…. Pas encore les ténèbres. L’effondrement progressif de la lumière. Extase où la mort bave ses poisseuses secrétions.
Extase. Torpeur des frottements. Usure des chairs. Du temps.
Quant au reste c’est l’histoire d’une marée. Perpétuelle ignominie.
Vacuité insoutenable.
L’écriture tient dans cet effort à gagner une rive qui se refuse à notre brasse. Dans cet échec toujours renouvelé. Et consenti.
De la mer dont on est sorti il nous reste le mouvement lent et monotone, et parfois furieux, des marées.
L’impossible immobilité.
L’impossible rivage.
Et l’écriture s’essaye à définir les contours d’une réalité sur laquelle on ne pourra prendre pied.
Franck
 comme s’ils avaient trompés la vigilance du porteur de voix. Des mots débordés. Comme le coolie qui renverse l’eau du seau dans son transport. C’est l’eau rare. L’eau fertile. L’eau détournée. L’eau qui ne sera jamais bue. L’eau du retour. L’eau évadée. L’eau libre. L’eau qui fait fleurir les talus, celle qui inventera les routes futures. Des mots perdus. Comme de l’eau renversée.
comme s’ils avaient trompés la vigilance du porteur de voix. Des mots débordés. Comme le coolie qui renverse l’eau du seau dans son transport. C’est l’eau rare. L’eau fertile. L’eau détournée. L’eau qui ne sera jamais bue. L’eau du retour. L’eau évadée. L’eau libre. L’eau qui fait fleurir les talus, celle qui inventera les routes futures. Des mots perdus. Comme de l’eau renversée. 





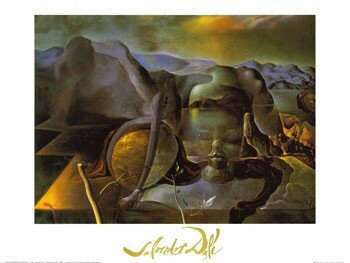


















/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F33321.jpg)